Lumière sur Louis Héliot, Prix SACD Jumelles d'or 2024

Responsable de la programmation cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris, grand cinéphile, auteur et coorganisateur de deux festivals, on le surnomme aussi « Monsieur Cinéma belge en France » : Louis Héliot remporte le Prix SACD Jumelles d’or 2024. Et « si la SACD le fête, c’est avant tout pour sa démarche de défricheur, de passeur des œuvres », et parce qu’il est de ceux qui « persiste à défendre le cinéma dans toute sa richesse et sa diversité ». Nous vous invitons à lire l’éloge rédigé par le Comité belge à son sujet, ainsi que l’interview inspirante réalisée par Stanislas Ide.
L'éloge du Comité belge
Depuis 1992, Louis Héliot est responsable d’une programmation cinéma exemplaire au Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris.
Mais il a aussi dirigé deux ouvrages captivants d’entretiens, Ces Belges qui font le cinéma français et Réaliser un film à deux, chacun paru aux Impressions Nouvelles. Et comme si cela ne suffisait pas, ce cinéphile boulimique organise aussi des Festivals comme Le court en dit long et La semaine du cinéma francophone.
Si la SACD le fête, c’est avant tout pour sa démarche de défricheur, de passeur des oeuvres. Voilà une personnalité qui, depuis des décennies, valorise le cinéma belge en invitant systématiquement dans une vraie salle de cinéma, les autrices, les auteurs et les équipes des films présentés, et sans jamais négliger d’assurer, à chaque fois,un débat passionnant.
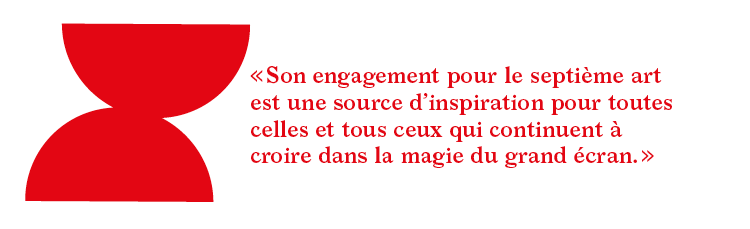
En ces temps où les plateformes cherchent à monopoliser la diffusion des oeuvres, où les chaînes de télévision sont de plus en plus frileuses envers le cinéma d’auteur, Louis persiste à défendre le cinéma dans toute sa richesse et sa diversité.
Son engagement pour le septième art est une source d’inspiration pour toutes celles et tous ceux qui continuent à croire dans la magie du grand écran.
Luc Jabon, membre du Comité belge de la SACD
Louis Héliot, Monsieur cinéma belge... en France

On l'appelle 'Monsieur cinéma belge'... mais en France ! Louis Héliot est le programmateur cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. Il organise à ce titre les festivals « Le court en dit long » et « La quinzaine du cinéma francophone », et facilite les sorties de films belges francophones dans les salles hexagonales. En poste depuis plus de trente ans, il a vu défiler tous les cinéastes belges de renom et se souvient, l'œil pétillant et le sourire en coin, des anecdotes qui vont de pair.
Vous portez plusieurs casquettes au sein du Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. Comment résumer votre métier ?
Je suis le responsable de la programmation cinéma du Centre Wallonie-Bruxelles. Ça, c'est le titre officiel. Quand on veut faire plus court, on m'appelle ‘Monsieur Cinéma Belge en France’. Dans le détail, il y a d'abord la programmation de la salle du Centre. Une salle qui n'est pas commerciale où l'on organise « Les rendez-vous des cinéastes », au cours desquels on présente, en avant-première et en présence des équipes, les films belges qui vont sortir en salle. Ça permet de travailler avec les différents distributeurs susceptibles de sortir les films. On participe aussi depuis longtemps au « Mois du film documentaire ». Et on organise deux festivals depuis plus de trente ans. Il y a « La quinzaine du cinéma francophone » qu'on organise depuis 1992, et « Le court en dit long » que j'ai mis en place en 1993. Là, je prépare la trente-troisième édition. Si on m'avait dit que j'en ferais autant, je n'y aurais jamais cru.
Vous avez pourtant fait des études littéraires...
J'ai même rejoint le centre pour m'occuper de littérature. C’était en 1991 et, pendant plusieurs mois, j’ai organisé des rencontres littéraires, un peu dans l'esprit de l'émission 'Apostrophe' de Bernard Pivot. Ces rencontres se déroulaient dans la salle de cinéma du centre et j'ai fait remarquer qu'on n'y projetait jamais de films. La directrice de l'époque, Geneviève François, m'a regardé avec ses grands yeux et demandé si le cinéma m'intéressait. Je lui ai dit oui et elle m'a engagé à l'essai sur cette matière. J'ai appris plein de choses sur le tas en travaillant avec les gens en charge du cinéma au ministère de la Communauté française de Belgique. J'ai notamment découvert le catalogue intitulé « Le court en dit long », qui recensait tous les courts-métrages produits dans l'année. Constatant que ces films étaient peu accessibles, je leur ai proposé d'organiser à Paris un festival du même nom. Ils m'ont pris pour un taré. Faut dire que dès la première année, j'ai programmé cent films. On projetait encore en 16 et 35 millimètres à l'époque. Ça faisait beaucoup de pellicule ! Mais ça a pris, si bien qu’une douzaine de courts ont été achetés par différentes télés.

© Une photo de Pierre Vanderstappe durant une soirée consacrée au film primé par la SACD cette année, Mambar Pierrette de l'autrice Rosine Mbakam
Avez-vous ressenti le besoin d'aiguiser votre connaissance cinématographique ?
Je me sentais légitime en littérature mais pas en cinéma. J'ai donc décidé de passer un mois à la Cinémathèque royale (aujourd'hui Cinematek, ndlr). J'avais demandé à la conservatrice de l'époque, Gabrielle Claes, de me montrer ce que j'étais censé avoir vu. Ça m'a permis d'avoir une bonne base.
Dès le début, vous ne vous êtes pas contenté de programmer des films...
Ma première programmation de cinéma a eu lieu quand j'étais encore à l'essai. Ça s'appelait « Un livre, un film » et ça se déroulait dans le cadre du « Salon du Livre » de Paris. Le ministère de la Fédération avait mis en place une exposition pour les bibliothèques des livres belges adaptés au cinéma. On a ouvert avec « Benvenuta » d'André Delvaux, qui est donc le premier cinéaste que j'ai rencontré. La chance du débutant, que voulez-vous ! Et ça a été un vrai coup de foudre. Au point où je suis devenu le modérateur des masterclasses qu'il donnait dans différents festivals. On est restés liés jusqu'à sa mort en 2002.
Diriez-vous que vous avez façonné votre poste vous-même, au gré des rencontres et des occasions ?
Beaucoup de choses restaient à inventer. Par exemple, Rémy Belvaux m'a appelé en 1992 après avoir présenté « C'est arrivé près de chez vous » au Festival de Cannes. Il venait de lire à tête reposée le contrat qu’il avait signé avec le vendeur international dans les brumes d'alcool du Festival de Cannes, et il se rendait compte que ça ne lui convenait pas du tout. Ça nous a soudés et, à partir de là, on a davantage accompagné et conseillé nos artistes en festival. Quelques mois plus tard, la bande des « Sept péchés capitaux » me demande si on peut organiser une projection à Paris après leur retour du Festival de Venise. J'ai bien compris où je mettais le pieds ce jour-là, car mon délégué général de l'époque m'a tapé sur les doigts. Pourquoi ? Un des comédiens, Urbanus, avait pris la parole en néerlandais ! On m’a bien fait comprendre que j'étais là pour aider les francophones et pas les Flamands. La même année, « Je pense à vous » des frères Dardenne a été présenté au FIFF, avec le succès que l'on sait. Mais ils n'avaient pas de distributeur en France. Jean-Pierre m'a demandé si je pouvais présenter le film aux distributeurs français. Je lui ai expliqué que je n'en connaissais pas un seul. Il m'a dit d'aller au kiosque à journaux, d'y acheter un exemplaire du « Film français », et de me débrouiller avec les coordonnées qui y étaient listées. C'était un peu bancal mais, en même temps, c'est là que j'ai compris que nous pouvions être utiles aux réalisateurs et aux producteurs qui cherchaient à diffuser leur œuvre en France. Ça m'a pris un an pour que tous les distributeurs français voient le film. Pour le coup, aucun d'entre eux n’a distribué « Je pense à vous » mais quelque chose était lancé grâce à cette connexion. Et grâce au festival du court-métrage, où je rencontrais des cinéastes et des producteurs émergents. On a ainsi trouvé des distributeurs français pour « Pardon Cupidon » de Marie Mandy, puis pour « Marie » de Marian Handwerker. C'est comme ça que tout s'est mis en place.

C'est l'époque où se dessine une véritable politique culturelle pour le cinéma en Fédération Wallonie-Bruxelles. Votre travail a-t-il contribué à la façonner ?
En partie, oui. Notamment avec l'union des producteurs et Patrick Quinet pour ne pas le citer. Saga Film existait déjà, Artemis et Entre Chien et Loup ont suivi le pas. Et en 1995, le Collectif 95 s'est mis en place avec tous les jeunes cinéastes et producteurs belges pour réclamer une véritable politique audiovisuelle en Belgique francophone. Une des images fortes de ce mouvement, c'était la manifestation au Festival du Film de Bruxelles. Ils s'étaient rassemblés et tenaient tous une valise en main devant la Gare du Midi, scandant qu'ils étaient obligés de s'exiler à Paris pour faire du cinéma. Plusieurs d'entre eux m'ont demandé de les aider pour se faire accréditer à Cannes cette année-là. Je ne me rendais pas compte que, ce faisant, je les aidais à organiser un coup médiatique depuis le toit du Palais des festivals, où ils sont montés pour déplier une grande banderole. J'étais complice sans le savoir et on m'a sermonné pour ça. Mais ce n’est pas grave, je suis toujours là ! En tout cas, on voyait bien qu'énormément de films n'arrivaient pas à sortir. On s'est mis à discuter avec les distributeurs français, qui nous ont expliqué qu'il fallait impliquer des coproducteurs français en amont pour assurer une sortie en salles françaises. J'avais l'avantage de connaître tous les distributeurs grâce à la mission que m'avaient donnée Luc et Jean-Pierre. C'est comme ça qu'on a développé le réseau, en évitant de mettre tous nos œufs dans le même panier. Et je constate que, depuis quatre ou cinq ans, on revit la même chose.
Pour quelle raison ?
Il y a beaucoup plus de films. Quand le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel a mis en place la commission des productions légères, c'était formidable parce que ça a permis à plein de cinéastes de pouvoir s'exprimer. Sauf que la plupart de ces films sont des productions cent pour cent belges. Quand un film est coproduit avec la France, il suffit que dix pour cent de son financement soit français pour que le distributeur reçoive des aides automatiques de la part du Centre national du cinéma. Le risque de sortir un film est donc plus grand avec les films cent pour cent belges. Or, en ce moment le turnover dans les salles est à son maximum. Et les gros films prennent beaucoup de place. Certains sortent parfois dans mille salles à la fois. Les films indépendants qui sortent la même semaine doivent se contenter d'une cinquantaine au mieux.
Beaucoup de talents établis ont bénéficié de l'appui du Centre Wallonie-Bruxelles à leurs débuts...
Pour la trentième édition du festival, on a collecté quelques témoignages de cinéastes que le centre a aidé à faire découvrir. Parmi eux, il y avait Patar et Aubier pour leur premier « Pic Pic et André ». À l’époque, ils ont réussi à faire acheter le second court par Canal+, dont les employés se passaient la VHS en boucle tellement ça les faisait marrer. Mon nom apparaît même dans le générique du troisième, où Pic Pic et André m'offrent deux bières pour me remercier de mon aide.
D'où vous vient ce plaisir de partager ?
Avant d'entrer au centre, j'ai été professeur de français durant quelques mois. Je pense que j'ai toujours un prof au fond de moi. Car ce que j'aime le plus, c'est la vulgarisation. Quand on justifie que peu de films belges sont programmés sur les grandes chaînes de télévision sous prétexte que le public n'a pas envie de ça, je ne suis pas d'accord. À mes débuts, quand je montrais les films d'Henri Storck, j'avais peu de spectateurs, mais j'en ai montré de plus en plus. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c’est en voyant des films qu'on devient cinéphile. Et donc en montrant des films belges qu'on fait en sorte que le public les apprécie. Si on ne les montre jamais, il aura de la difficulté à les voir. C'est limpide.
Propos recueillis par Stanislas Ide
Pour aller plus loin
- Faire un tour sur le site du Centre Wallonie-Bruxelles Paris et découvrez sa programmation
- Consultez la page Facebook et l'Instagram du Centre Wallonie-Bruxelles Paris
- Jetez un oeil à l'Instagram de Louis Héliot et suivez son actualité
- Découvrez le Palmarès des Prix SACD 2024

© Une photo de Pierre Vanderstappe durant une classe de cinéma de Xavier Seron, auteur ayant reçu le Prix SACD Audiovisuel 2024

© Richard Olivier
Né le 2 mars 1970. Louis Héliot étudie le violon de 1979 à 1985 et poursuit des études de lettres classiques, en Hypokhâgne et Khâgne, puis à la Sorbonne. Il entre au Centre Wallonie- Bruxelles/Paris en août 1991 pour La Fureur de lire puis ouvre le département cinéma en février 1992. La Quinzaine du cinéma francophone (1992), le Festival Le Court en dit long (1993), les « Rendez-vous des cinéastes » rythment les saisons. Sans oublier quelques publications.
